Nous vivons une période de l’année marquée par la remise de prix prestigieux aux divers couronnements cinématographiques. Les quatre films présentés ici en ont récolté leur juste part. Bon cinéma !
Anatomie d’une chute

Réalisé par Jonathan Glazer, largement récompensé, ce film tout en nuances a reçu de multiples nominations aux Oscars et aux Césars. Excellents acteurs, photographie superbe, suspense permanent, analyse psychologique sensible, tout contribue à rendre crédible le dénouement final d’une affaire judiciaire complexe.
À l’origine du drame : la chute d’un homme tombé d’une fenêtre du chalet, au milieu des Alpes, et retrouvé mort dans la neige. Suicide ou meurtre, telle est la question.
Mais la « chute » dont il s’agit est aussi celle d’un couple de romanciers dont le mariage bat de l’aile. De ce couple, lui est en panne d’inspiration et frustré; elle, autrice d’une œuvre à succès. Ils sont les parents d’un garçon de 11 ans, malvoyant, replié dans sa bulle, avec son chien pour seul confident.
Le procès qui suivra fera de l’épouse la suspecte toute désignée. C’est un procès à la française, l’accusée ayant le fardeau de la preuve, et le procureur intervenant à bâtons rompus, contrairement au droit britannique. Je me garde d’en révéler le dénouement.
Un film à voir pour sa composition puissante. Comme spectateurs, nous sommes interpellés par un acte d’accusation impitoyable, des plaidoiries ambivalentes et un verdict imprévisible.
The Zone of Interest
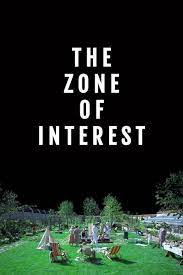
Un film coup-de-poing, mais indispensable pour qui veut réfléchir à sa propre attitude face à l’obéissance à un État criminel. La zone d’intérêt dont il s’agit – qualifiée ainsi par les SS -, c’est, bien sûr, le camp d’Auschwitz, avec son million et plus de personnes exterminées.
Coeurs sensibles, vous n’assisterez à aucune exécution de masse, vous ne verrez aucun bourreau à l’oeuvre. Vous n’entendrez – en sourdine – que des détonations, des cris et des aboiements, et une musique d’une efficacité magistrale. Vous ne contemplerez, le jour ou la nuit, que la fumée des fours crématoires, un mur et ses barbelés, et vous imaginerez le reste. (Alfred Hitchcock disait avec raison que ce que l’on ne voit pas est le plus terrifiant).
Car l’action du film se déroule de ce côté-ci du mur, à quelques dizaines de mètres, dans un cadre éblouissant de beauté, avec jardins verdoyants, maison cossue, ruisseau pour se rafraîchir et jeux pour les enfants. Il s’agit là d’un fait vécu, à quelques nuances près. Rudolph Höss, le commandant du camp, sa femme et leurs enfants y mènent une existence bourgeoise. Vraie figure historique (il sera pendu en 1947), Höss n’a d’autre souci que l’efficacité accrue de son nouveau four pour lequel son Führer l’a récompensé. Quant à sa femme, elle se complaît de fourrures et de bijoux prélevés aux détenues du camp, et cela sans aucun état d’âme. Ce contraste entre deux mondes est glaçant. Le malaise grandit devant l’indifférence des protagonistes, à savoir des officiers SS magnifiquement décorés. La banalité du mal (selon Hanna Arendt) s’impose au spectateur comme une donnée normale de leur vie quotidienne. En est-il de même pour nous?
L’intelligence de la mise en scène ( neuf ans de tournage), l’horreur distillée par petites touches, la naïveté des enfants face à l’hypocrisie des adultes, tout contribue à évoquer le cynisme et la corruption régnante. On comprend pourquoi ce film a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes et fut en nomination aux Golden Globes. L’image qui m’a le plus terrifié est la dernière du film où Rudolph Höss fixe pour la première fois les spectateurs que nous sommes, semblant dire : « Et vous, dans ce cortège de souffrances et d’exploitation, de quel côté êtes-vous? »
Io capitano (Moi,capitaine)

Ce film est un suspense de 125 minutes, insoutenable – hélas – à cause de sa vraisemblance avec l’actualité, celle des milliers de migrants africains, dans leur marche désespérée vers l’Europe. Il est estimé que 6% seulement de ces réfugiés atteignent leur destination, les autres étant dépouillés de leurs biens, refoulés, vendus ou tués.
Le film raconte l’histoire d’une cohorte de Sénégalais, et spécialement de deux jeunes gens, voulant traverser le Mali, le Sahara puis la Libye, avant d’affronter la Méditerranée. L’un de ces deux garçons deviendra même, à son corps défendant, le capitaine d’un rafiot mis à leur disposition.
Le puissant jeu des acteurs presque tous non professionnels, la musique dramatique, la photographie sans complaisance et le scénario crédible, tout contribue à faire comprendre au spectateur les causes et les conséquences du drame, l’émotion en plus. Chez ces réfugiés apparaissent aussi des élans de solidarité et de dignité, en contraste avec les exactions sordides de leurs passeurs.
À vous de découvrir le punch final!
Perfect Days

Wim Wenders avait déjà réalisé Paris Texas et Les ailes du désir. Perfect days est d’une beauté lumineuse. D’abord, le contraste entre le gigantisme de Tokyo et le dépouillement d’un appartement exigu est frappant. Là, vit un homme seul, menant une vie simple et routinière à l’extrême : Hirayama. Son métier : nettoyeur des toilettes publiques. Ses contacts sociaux : modestes. Ses conversations : presque inexistantes.
« Un protagoniste dont la façade zen se lézarde parfois, brièvement, le temps de révéler un possible chagrin, un possible regret, derrière… » François Lévesque, Le Devoir, 9/02/24
Car tout, dans ce film, tient au regard du personnage (L’acteur a d’ailleurs remporté plusieurs prix d’interprétation masculine). Confronté à quelques rencontres fugitives – un collègue, une nièce, un inconnu, la serveuse de resto – il ne renonce pas à sa maîtrise de soi et à son empathie discrète, comme si le Destin était inexorable.
Bref, un portrait tout en subtilité pudique et attachant, à l’image du caractère japonais, intériorisé et fier.
Mot de la fin
Merci, chers collègues, pour avoir enrichi cette chronique de vos observations judicieuses, lors de notre ciné-club du 28 février.

